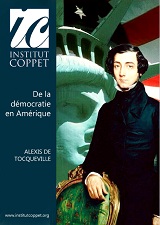
Dans mon prochain ouvrage, « La dictature insidieuse – Entre totalitarisme et chaos », je compte exposer l’idée selon laquelle la démocrate française serait aujourd’hui menacée par une forme de dérive totalitaire. Mais je suis en même temps très conscient du caractère apparemment excessif de cette affirmation, la situation actuelle de notre pays n’ayant évidemment rien à voir avec les abominations nazies ou staliniennes. L’ouvrage d’Alexis de Tocqueville, « De la démocratie en Amérique », fournit en quelque sorte une solution à mon dilemme. L’auteur y exprime en effet, dans sa célèbre conclusion, sa crainte de voir la démocratie dériver peu à peu vers une forme de douce tyrannie où l’Etat étendrait son pouvoir immense, à la fois bienveillant et infantilisant, sur tous les aspects de la vie des individus, rendus égoïstes et indifférents les uns aux autres par le nivellement égalitariste. Et c’est à cette version « douce » du totalitarisme – un Etat qui contrôlerait jusqu’au moindre détail de la vie sociale par une infinité de règles paralysantes, tout en maintenant les formes extérieures de la liberté -, que je ferai désormais référence dans la suite de mes travaux.
*
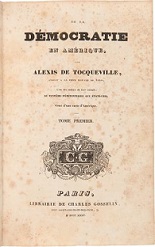
L’ouvrage fut rédigé par Alexis de Tocqueville entre 1835 et 1840, à la suite d’un voyage d’études sur le système carcéral des Etats-Unis, effectué en 1831 à la demande du gouvernement français de l’époque. L’essentiel du livre – ses trois premiers tomes – est consacré à une analyse de la démocratie américaine, de ses influences sur les mœurs du pays et de ses évolutions possibles[1]. Mais l’auteur élargit ensuite sa réflexion, dans le quatrième tome, à l’ensemble des régimes démocratiques, dont il essaye, à travers une comparaison systématique avec les anciens régimes aristocratiques, de comprendre en quoi ils sont en train de façonner, dans tous les domaines de l’existence individuelle et de la vie sociale, un nouveau système de valeurs, une nouvelle manière d’être et un nouveau type de relations entre les hommes. Avant d’en tirer, en quelques paragraphes lumineux, sa célèbre prophétie sur le devenir des démocraties (voir annexe en fin d’article). Tentons donc de résumer son propos en quelques idées forces.
Egalité des conditions et isolement des individus. L’égalité des conditions provoque dans les démocraties un adoucissement général des mœurs. Les distinctions de caste ayant été supprimées, tous les individus sont en effet désormais semblables. Chacun s’identifie donc plus volontiers aux autres, entretenant avec eux des rapports plus simples et plus aisés. Par exemple, l’ancienne autorité paternelle ayant perdu son caractère absolu, l’attitude de respect filial, froide et formelle, du fils vis-à-vis du père est remplacée par des liens d’attachement personnels plus chaleureux. Mais en même temps, l’idéal d’égalité fait que l’homme démocratique, contrairement à l’homme aristocratique immergé dans un système hiérarchisé de fidélités et de protections, n’éprouve plus aucun sentiment d’allégeance vis-à-vis d’un quelconque corps social autre que le pouvoir central[2], et n’accepte plus d’être soumis à l’influence d’aucun autre individu. De ce fait, il devient indifférent aux autres, s’isole, et finalement s’affaiblit. Et, paradoxalement, sa liberté poussée à l’extrême favorise alors l’émergence de formes nouvelles de despotisme. Dédaignant de se conformer à l’opinion d’un autre individu, l’homme démocratique n’aura en effet d’autre ressource que de se soumettre à la toute-puissance de l’opinion commune, avec pour conséquence un affadissement de la pensée et une montée du conformisme. La liberté poussée à l’extrême soumet ainsi paradoxalement l’individu aux exigences de la majorité de ses concitoyens.
Individualisme et perte du sens du devoir. L’homme démocratique n’est plus enfermé, comme c’était le cas au sein de la société aristocratique, dans un carcan d’obligations et de privilèges liés à sa naissance. S’il est de ce fait délivré de ce que ces contraintes pouvaient avoir d’étroit et d’absurde, il est aussi privé de ce qu’elles comportaient de noblesse d’âme et d’oubli de soi : valeurs d’honneur, de devoir, de fidélité… Les membres de la société deviennent de ce fait plus indifférents les uns aux autres, ce qui distend le lien social. Maître et serviteurs, par exemple, ne sont plus unis par un attachement durable entre deux personnes dont les conditions respectives sont à jamais fixées dès leur naissance, mais par un simple accord de circonstance entre deux égaux dont l’un accepte provisoirement de servir l’autre moyennant rétribution. Quant à la disparition du sens de l’honneur, elle fait peut-être tomber en désuétude des pratiques absurdes comme le duel, mais affaiblit également l’esprit de dévouement militaire. Repliés sur les petites ambitions de l’enrichissement personnel et du bien-être matériel, les individus perdent alors le sens de l’abnégation, des grandes entreprises et des grandes ambitions. Personne n’accepte plus de se sacrifier pour la communauté comme le faisait l’homme aristocratique. Seule la religion serait désormais en mesure, selon Tocqueville, de contrebalancer les tendances malsaines de l’homme démocratique au repli sur soi, en stimulant ses capacités d’altruisme et de désintéressement.
Esprit de liberté et concentration du pouvoir central. La démocratie risque de faire apparaître de nouvelles formes de despotisme plus douces mais aussi plus étendues que le despotisme aristocratique. En effet, la crainte du désordre et l’amour du bien-être portent insensiblement les peuples démocratiques à augmenter les attributions du gouvernement central, seul pouvoir qui leur paraisse de lui-même assez fort, assez intelligent, assez stable pour les protéger contre l’anarchie. « Si l’on vient à réfléchir sur ce qui précède, on sera surpris et effrayé de voir comment, en Europe, tout semble concourir à accroître indéfiniment les prérogatives du pouvoir central et à rendre chaque jour l’existence individuelle plus faible, plus subordonnée et plus précaire. » Cette tendance est liée selon Tocqueville à plusieurs causes :
- La contradiction interne du principe d’égalité. Dans la société démocratique, l’idée d’égalité prévaut. Mais, dans la pratique, cette passion égalitaire propre à l’homme démocratique est constamment remise en cause par l’apparition de nouvelles inégalités de fortune nées de la mobilité sociale, de la concurrence et de l’accumulation des richesses. D’où l’apparition de nouvelles forme de tensions dans les rapports humains, chaque individu devenant à la fois « plus jaloux d’un rang qui n’est plus garanti par la naissance et de l’égalité stricte dans laquelle tous les hommes doivent être cantonnés ». Seul le pouvoir central paraît alors en mesure de ramener la société vers cette égalité idéale, en affaiblissant les nouveaux privilèges toujours renaissants, afin de réactiver le lien social. D’où des interventions de plus en plus nombreuses de ce pouvoir central, qui ont aussi pour conséquence de rogner les ailes de ceux qui sont porteurs de grandes idées et de grandes ambitions.
- Les contradictions du repli individualiste. Les sociétés démocratiques donnent aux individus le goût des institutions libres. Mais elles les conduisent en même temps à se concentrer sur la passion du bien-être personnel, et à se désengager des grandes causes communes. Ils acceptent de ce fait de renoncer à l’exercice de leur pouvoir politique, ce qui entraîne la concentration de ces pouvoirs aux mains de quelques-uns. Ceci peut constituer la source d’une nouvelle forme de despotisme, d’autant que la disparition des corps intermédiaires a conduit le pouvoir politique central à s’emparer de nouvelles attributions. Mais, tout en haïssant souvent les dépositaires du pouvoir central, accusés de tyrannie, les peuples démocratiques aiment par contre toujours ce pouvoir lui-même, dont la puissance croissante constitue en réalité un effet de leur volonté.
- Le développement de l’industrie. Ce phénomène, lui-même favorisé par les progrès de l’égalité, contribue sans cesse, selon Tocqueville, à étendre l’action du souverain ou à augmenter ses prérogatives. En effet, « en proportion que la nation devient plus industrielle, elle sent un plus grand besoin de routes, de canaux, de ports et autres travaux d’une nature semi-publique, qui facilitent l’acquisition des richesses, et en proportion qu’elle est plus démocratique, les particuliers éprouvent plus de difficulté à exécuter de pareils travaux, et l’état plus de facilité à les faire. Je ne crains pas d’affirmer que la tendance manifeste de tous les souverains de notre temps est de se charger seuls de l’exécution de pareilles entreprises ; par-là, ils resserrent chaque jour les populations dans une plus étroite dépendance ». En particulier, ils finissent par détenir la plus grande partie des richesses : « Ainsi, l’état attire à lui l’argent des riches par l’emprunt, et par les caisses d’épargne il dispose à son gré des deniers du pauvre. Près de lui et dans ses mains, les richesses du pays accourent sans cesse ; elles s’y accumulent d’autant plus que l’égalité des conditions devient plus grande ; car, chez une nation démocratique, il n’y a que l’état qui inspire de la confiance aux particuliers, parce qu’il n’y a que lui seul qui leur paraisse avoir quelque force et quelque durée. Ainsi le souverain ne se borne pas à diriger la fortune publique ; il s’introduit encore dans les fortunes privées ; il est le chef de chaque citoyen et souvent son maître, et, de plus, il se fait son intendant et son caissier. […] D’autre part, à mesure que la puissance de l’état s’accroît, et que ses besoins augmentent, il consomme lui-même une quantité toujours plus grande de produits industriels, qu’il fabrique d’ordinaire dans ses arsenaux et ses manufactures. C’est ainsi que, dans chaque royaume, le souverain devient le plus grand des industriels ; il attire et retient à son service un nombre prodigieux d’ingénieurs, d’architectes, de mécaniciens, et d’artisans. Il n’est pas seulement le premier des industriels, il tend de plus en plus à se rendre le chef ou plutôt le maître de tous les autres. »
- La tentation éprouvée par le Prince de s’occuper de tous les aspects de la vie de ses sujets : « Il est évident que la plupart de nos princes ne veulent pas seulement diriger le peuple tout entier ; on dirait qu’ils se jugent responsables des actions et de la destinée individuelle de leurs sujets, qu’ils ont entrepris de conduire et d’éclairer chacun d’eux dans les différents actes de sa vie, et, au besoin, de le rendre heureux malgré lui-même. »
La transition vers la démocratie provoque donc, après une période transitoire d’affaiblissement du pouvoir central, un renforcement de celui-ci : « d’un côté, les plus fermes dynasties sont ébranlées ou détruites ; de toutes parts les peuples échappent violemment à l’empire de leurs lois ; ils détruisent ou limitent l’autorité de leurs seigneurs ou de leurs princes ; toutes les nations qui ne sont point en révolution paraissent du moins inquiètes et frémissantes ; un même esprit de révolte les anime. Et de l’autre, dans ce même temps d’anarchie et chez ces mêmes peuples si indociles, le pouvoir social accroît sans cesse ses prérogatives ; il devient plus centralisé, plus entreprenant, plus absolu, plus étendu. Les citoyens tombent à chaque instant sous le contrôle de l’administration publique ; ils sont entraînés insensiblement, et comme à leur insu, à lui sacrifier tous les jours quelques nouvelles parties de leur indépendance individuelle, et ces mêmes hommes qui de temps à autre renversent un trône et foulent aux pieds des rois, se plient de plus en plus, sans résistance, aux moindres volontés d’un commis. »
Et nous en arrivons enfin à la fameuse prophétie de Tocqueville sur l’avenir des régimes démocratiques, qui constitue également la conclusion de son ouvrage, et dont vous pouvez lire l’extrait le plus célèbre dans l’annexe située en fin de ce texte.
*
Un lecteur moderne, féru de méthode scientifique, peut être a priori surpris par la démarche de Tocqueville. Les développements de celui-ci ne s’appuient en effet jamais sur l’analyse de faits précis mais exclusivement sur des hypothèses et des déductions à caractère très général et très abstraites. D’où d’impression que l’on ressent parfois de lire une succession d’affirmations fondées exclusivement sur la conviction – certes argumentée avec finesse – de l’auteur, mais jamais démontrées de manière scientifique. Nous apprenons ainsi, pêle-mêle, que l’égalisation des conditions permet un adoucissement des mœurs, que la démocratie tend à augmenter le prix des baux en accroissant la concurrence entre les fermiers, ou encore que les armées des régimes démocratiques désirent naturellement la guerre parce que celle-ci offre des possibilités d’avancement rapide aux sous-officiers et officiers. Autant d’affirmations dont il est, au fond, impossible de vérifier la pertinence tant elles ne sont fondées sur aucun fait concret. Et, qui parfois, semblent profondément déconnectées de nos valeurs contemporaines tant elles sont imprégnées des préjugés de l’époque de Tocqueville, comme ses étranges développements sur les rapports entre démocratie et bonnes mœurs féminines.
L’ouvrage possède cependant d’immenses qualités qui incitent à surmonter ces quelques réserves. L’approche de Tocqueville s’appuie en effet sur une comparaison systématique entre le fonctionnement des régimes démocratiques et aristocratiques, l’idée étant à chaque fois d’analyser les conséquences d’un certain type d’organisation politico-sociale sur les mœurs et les comportements des individus. Cette comparaison entre « l’homme démocratique » et « l’homme aristocratique », à une époque où le souvenir des anciennes valeurs n’a pas encore disparu, permet alors de relativiser nos propres a priori sur la démocratie, en comprenant le caractère relatif du système de valeurs qu’elle nous propose. Les pages consacrées par Tocqueville à la logique de l’honneur dans les systèmes aristocratiques, opposée au caractère matérialiste et pragmatique des régimes démocratiques, est par exemple particulièrement éclairante pour comprendre nos mentalités d’hommes du XXIème siècle, en nous montrant que ce nous croyons être par libre choix – pacifiques, industrieux, épris d’égalité, à la fois individualistes et convaincus de la légitimité de l’Etat – n’est en fait que le produit des principes au fond très relatifs des régimes démocratiques qui ont façonné nos valeurs et notre vision du monde.
Par ailleurs le livre contient, à côté d’idées discutables ou invérifiables, un certain nombre d’intuitions lumineuses, par exemple lorsque Tocqueville explique que les peuples démocratiques, par nature industrieux et animés par la passion du bien-être, sont de ce fait peu portés à la guerre, aux révolutions radicales et aux grandes ambitions morales ; ou encore quand il analyse magnifiquement la contradiction profondes des sociétés démocratiques, où les individus sont à la fois avides de libertés toujours plus grandes pour eux-mêmes et disposés à accepter que le pouvoir se concentre toujours davantage aux mains d’un Etat apprécié pour son rôle de dispensateur de places et d’avantages…
Cet ouvrage reste dans ces conditions, au-delà de quelques passages un peu vieillis, d’une très grande actualité pour comprendre l’existence de tendances à la tyrannie – nous dirions aujourd’hui de possibles dérives totalitaires – profondément inscrites dans le code génétique des régimes démocratiques.
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835-1840, réédition en ligne Institut Coppet, 635 pages
Pour comprendre la pensée de Tocqueville, Voir aussi Pierre Manent Tocqueville et la nature de la démocratie, Gallimard, 1982, rééd. Fayard, 2006.
Nb : cette fiche de lecture s’inscrit dans mon actuel travail de rédaction d’un ouvrage intitulé « La dictature insidieuse – Entre totalitarisme et chaos », où je tente de mettre à jour les mécanismes par lesquels l’Etat français contemporain réduit peu à peu nos libertés. Pour tester mes hypothèses de travail, je suis en ce moment amené à lire un grand nombre d’ouvrages, récents ou plus anciens, portant sur ces questions. Comme les autres comptes rendus de lecture du même type que j’ai publié au cours de l’année 2019, le texte ci-dessous ne porte donc pas directement sur l’ouvrage lui-même, mais sur la manière dont il confirme ou infirme les thèses que je souhaite développer dans mon propre livre, et que je présente au début du compte-rendu sous la forme d’un encadré liminaire, afin de les tester à l’aune de cette nouvelle lecture.
[1] Les trois fondements de la démocratie étant, selon Tocqueville, l’égalité des conditions, la souveraineté du peuple et la toute-puissance de la société sur elle-même.
[2] Par « le pouvoir central », le lecteur d’aujourd’hui comprend immédiatement « l’Etat ». Mais curieusement, Tocqueville utilise assez rarement ce dernier terme dans son ouvrage.
Annexe : un célèbre passage de « La démocratie en Amérique »
Lorsque je songe aux petites passions des hommes de nos jours, à la mollesse de leurs moeurs, à l’étendue de leurs lumières, à la pureté de leur religion, à la douceur de leur morale, à leurs habitudes laborieuses et rangées, à la retenue qu’ils conservent presque tous dans le vice comme dans la vertu, je ne crains pas qu’ils rencontrent dans leurs chefs des tyrans, mais plutôt des tuteurs. Je pense donc que l’espèce d’oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l’a précédée dans le monde; nos contemporains ne sauraient en trouver l’image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain moi-même une expression qui reproduise exactement l’idée que je m’en forme et la renferme; les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tacher de la définir, puisque je ne peux la nommer.
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde: je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres: ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas; il les touche et ne les sent point; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie.
Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre?
C’est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l’emploi du libre arbitre; qu’il renferme l’action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu chaque citoyen jusqu’à l’usage de lui-même. L’égalité a préparé les hommes à toutes ces choses: elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait.
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l’avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige; il force rarement d’agir, mais il s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse; il ne détruit point, il empêche de naître; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger.
J’ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu’on ne l’imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté, et qu’il ne lui serait pas impossible de s’établir à l’ombre même de la souveraineté du peuple.
Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies : ils sentent le besoin d’être conduits et l’envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l’un ni l’autre de ces instincts contraires, ils s’efforcent de les satisfaire à la fois tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout-puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d’être en tutelle, en songeant qu’ils ont eux-mêmes choisi leurs tuteurs. Chaque individu souffre qu’on l’attache, parce qu’il voit que ce n’est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même, qui tient le bout de la chaîne. Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent.
Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui s’accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus, quand c’est au pouvoir national qu’ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m’importe bien moins que l’obéissance.